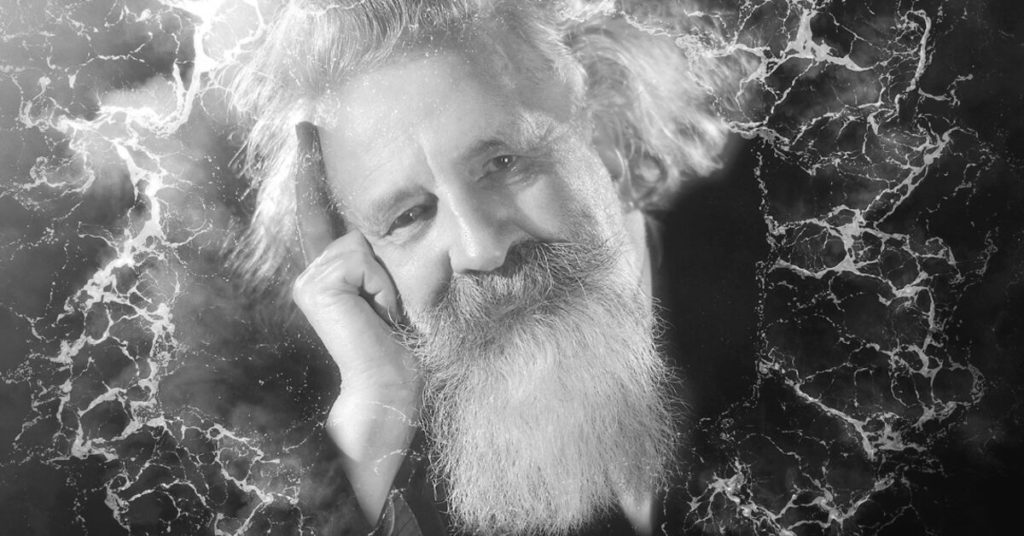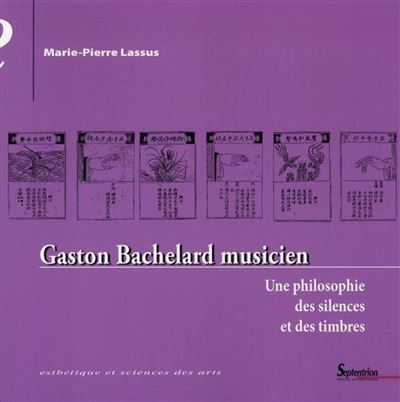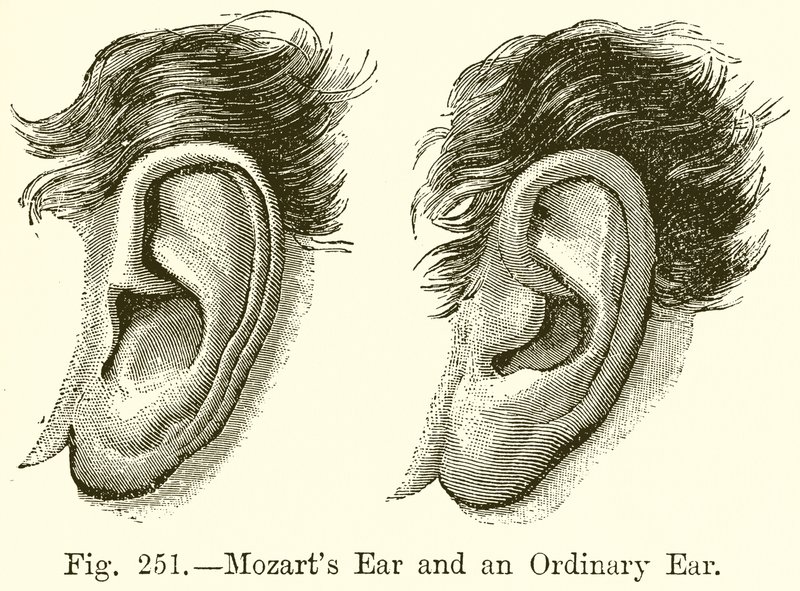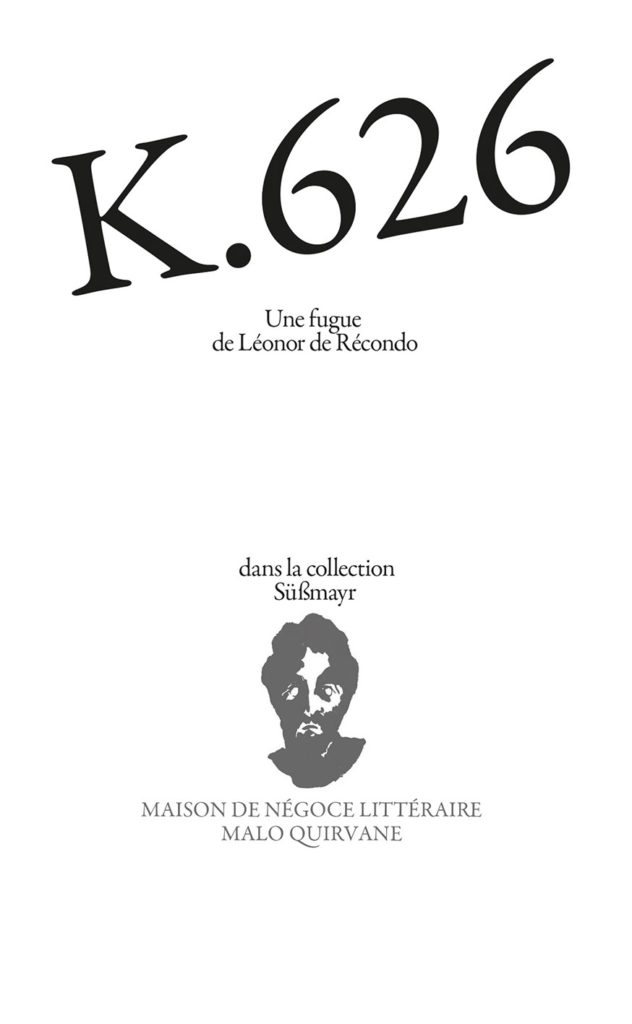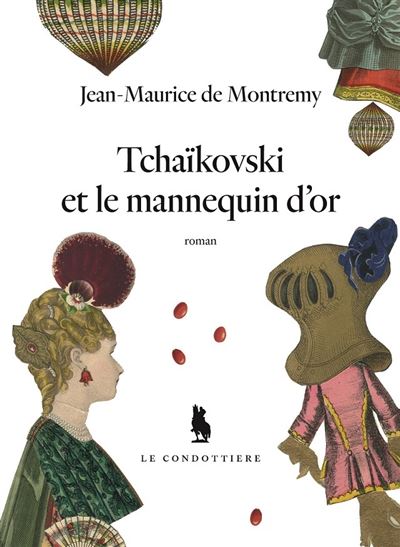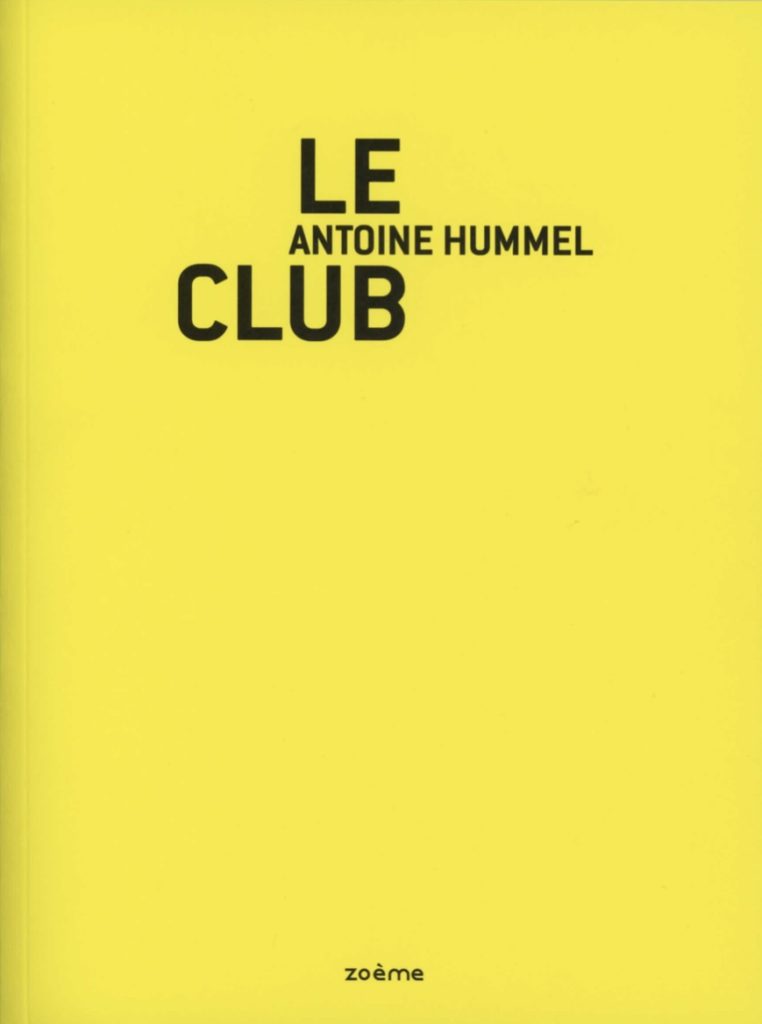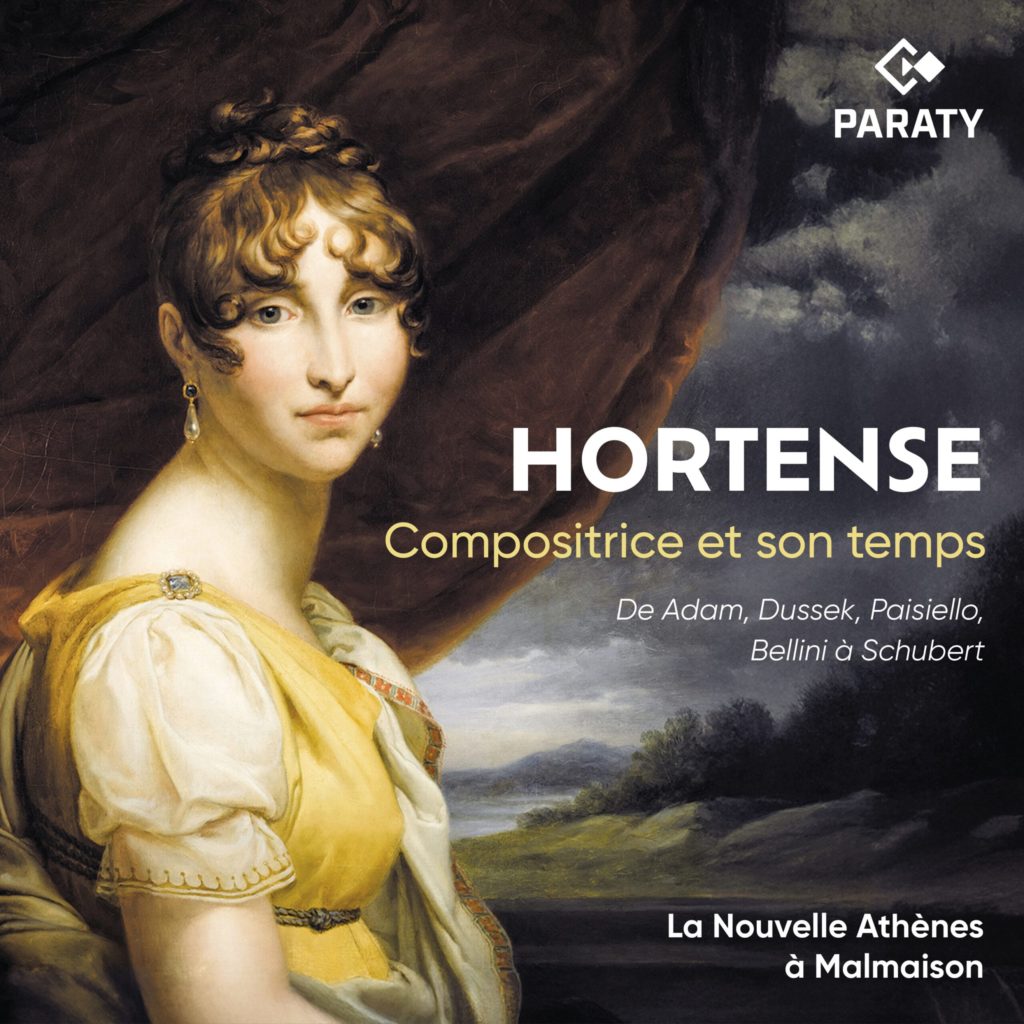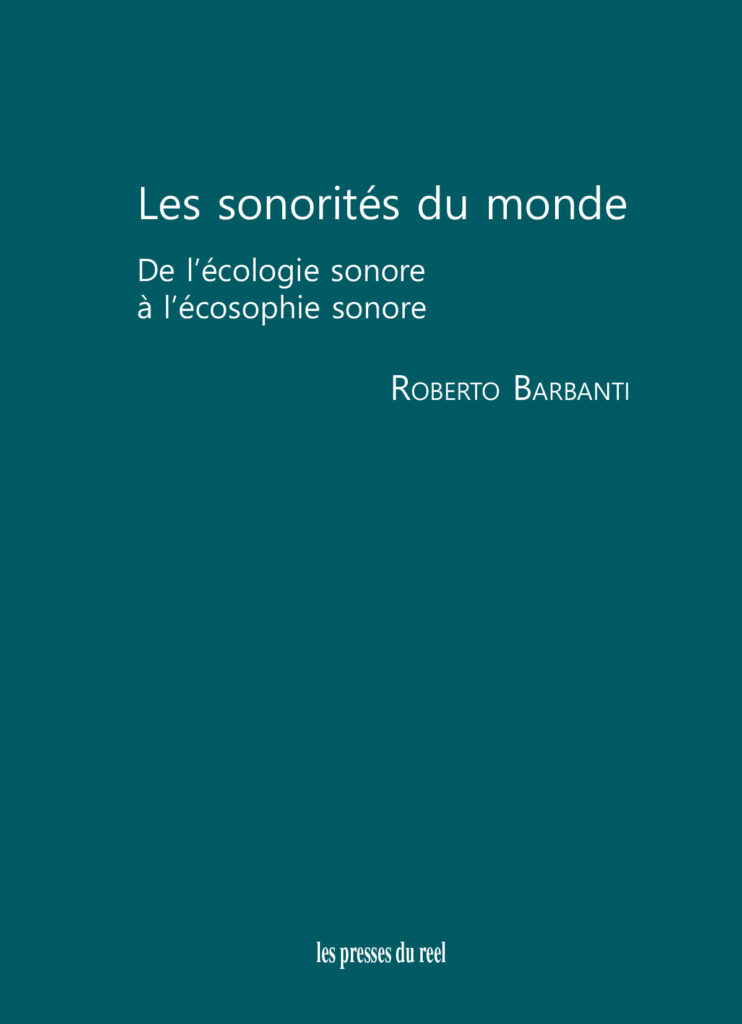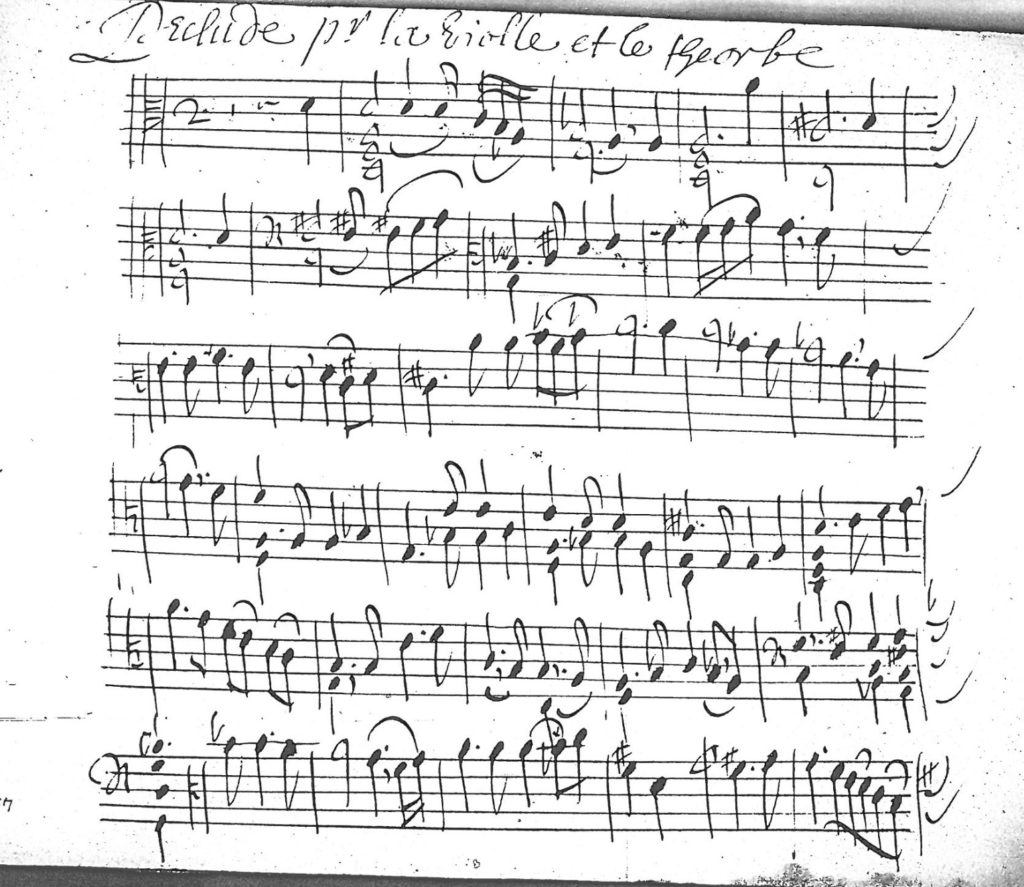
Jouer les pièces de viole de gambe de Marin Marais pose aussitôt la question : faut-il y ajouter des ornements ? La violiste Florence Bolton dit que « c’est sur la musique de Marais que j’ai envie de rajouter le moins d’ornements » pour des raisons essentiellement historiques. Mathilde Vialle ne rajoute que très rarement des ornements pour des raisons plus esthétique, en disant qu’elle trouve cela « très beau comme ça ». François Joubert-Caillet fait même « une distinction entre Marais pédagogue, qui écrit des doigtés, des ornements et des doubles par pur sadisme pédagogique pour faire progresser ses élèves, et Marais “live” qui joue sa musique sur le moment. » – au point qu’il en joue même moins qu’il en est écrit.
Ces trois violistes ont été interrogé sur la question par la violiste Juliette Guichard : élève de Myriam Rignol au CNSMD de Lyon, son travail de master a été lauréat du Prix de la recherche artistique 2025 remis à l’HEMU de Lausanne, en partenariat avec Metaclassique. Et pour soupeser en grand les questions soulevées par son travail, c’est avec les violistes Vittorio Ghielmi et Jonathan Dunford que Juliette Guichard nous a rejoint au studio Alain Trutat de la SCAM pour enregistrer ce numéro « Agrémenter » de Metaclassique.
Une émission organisée et animée par David Christoffel.
Podcast: Play in new window | Download