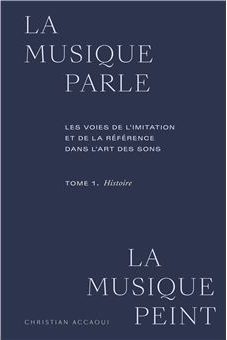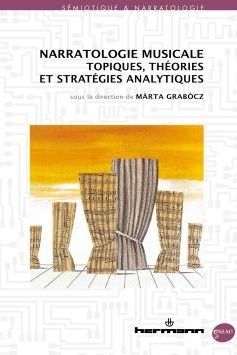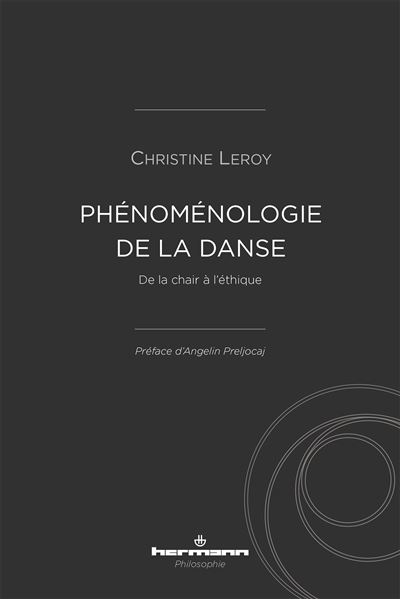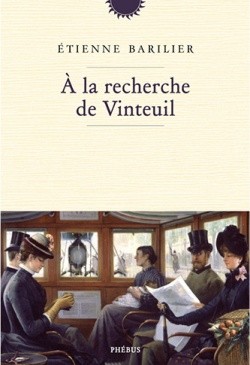Theodor Billroth était un chirurgien allemand très actif à la fin du 19è siècle et tenu pour le père fondateur de la chirurgie digestive. Passionné de musique, il était aussi violoniste virtuose et ami intime de Johannes Brahms. C’est à Theodor Billroth qu’un jour de l’été 1880, Brahms a écrit : « Mes nouvelles Danses Hongroises arriveront bientôt, je pense qu’elles nous amuseront. » De cette parole de maître arrachée à sa correspondance avec un ami proche, on pourrait conclure une bonne fois pour toute que les Danses hongroises si fameuses de Brahms sont donc faites rien que pour s’amuser. Mais, à l’usage, elles vont beaucoup plus loin. Il y a quelques semaines, j’ai pu voir un groupe de jeunes promeneurs qui accompagnaient sa ballade urbaine, au bord de l’eau, avec haut-parleur embarqué dans un sac à dos pour diffuser la 5ème de Danses hongroises de Brahms qui donnait un entrain à l’après-midi des amis de promenade qu’une bonne humeur et une franche camaraderie n’auraient peut-être pas suffi à provoquer. Alors, pour faire la preuve par l’expérience que cette musique de Brahms donne matière à Exulter, il fallait des complices. C’est donc avec la complicité de la compagnie théâtrale Turbulences que Metaclassique vous donne à entendre, pendant une heure, une seule œuvre à Exulter.
Une émission produite et réalisée par David Christoffel.
Podcast: Play in new window | Download