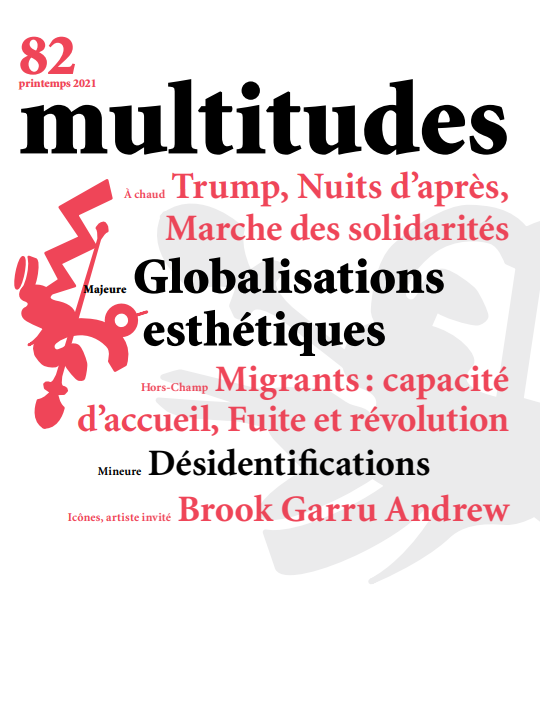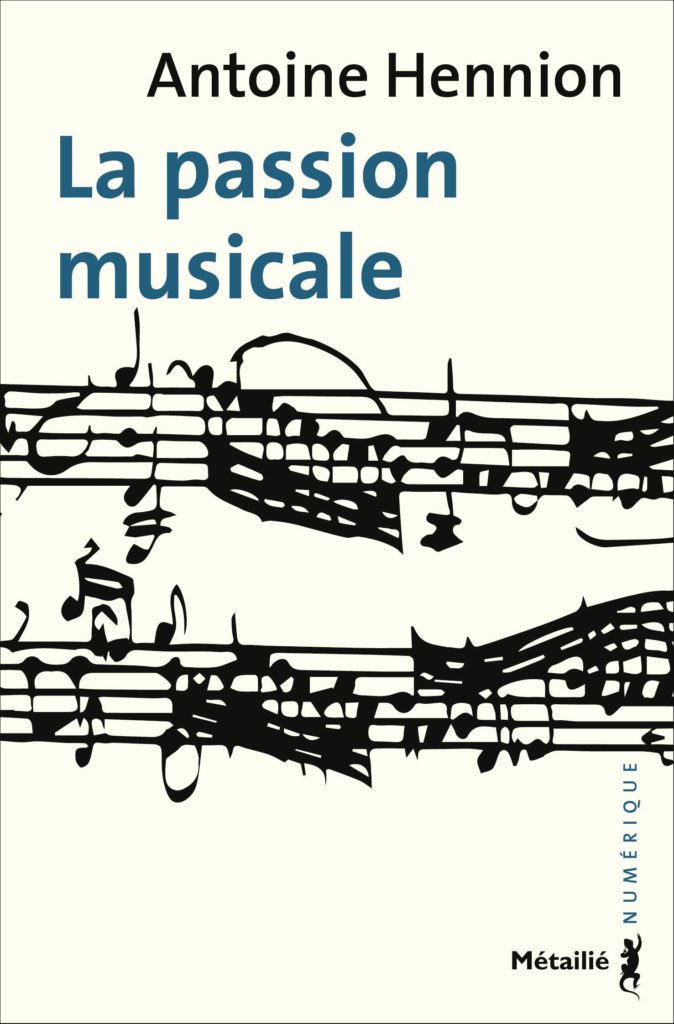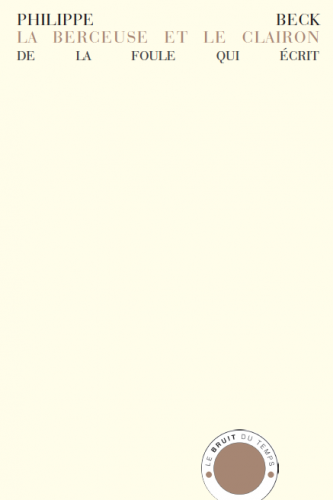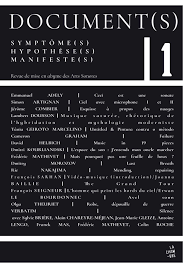Les captations d’opéra sont réputées donner une très faible satisfaction aux metteurs en scène qui peuvent avoir du mal à voir dans une version pour l’écran autre chose qu’une déformation des équilibres visuels qu’ils avaient imaginé pour la scène. Mais comme disait Marshall Mac Luhan : « Le ‘contenu’ d’un média, quel qu’il soit, est toujours un autre média. » On pourrait donc dire que la captation d’un opéra n’est jamais qu’un film. Mais on pourrait aussi dire, plus positivement, qu’un opéra filmé est toujours un film et qu’il peut donc justifier tous les soins qu’un cinéaste peut porter à la réalisation d’une œuvre pour l’écran. Pour ce numéro « cadrer » de Metaclassique, nous recevons le cinéaste devenu spécialiste du film d’opéra ou de film opéra, Philippe Béziat. Et pour donner un sens encore un peu plus plein au verbe cadrer, nous recevons aussi la sociologue Nathalie Heinich qui consacre aux CNRS éditions un livre à La cadre-analyse d’Erving Goffman, le sociologue américain qui avait fait du « cadre » un concept d’analyse de situations sociales cadrées, pour ne pas dire réglées, structurées et, quelquefois même, fabriquées.
Une émission produite et réalisée par David Christoffel.
Podcast: Play in new window | Download