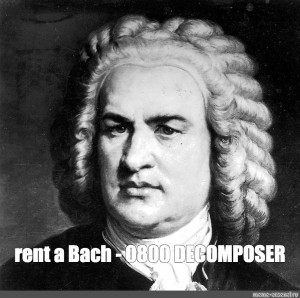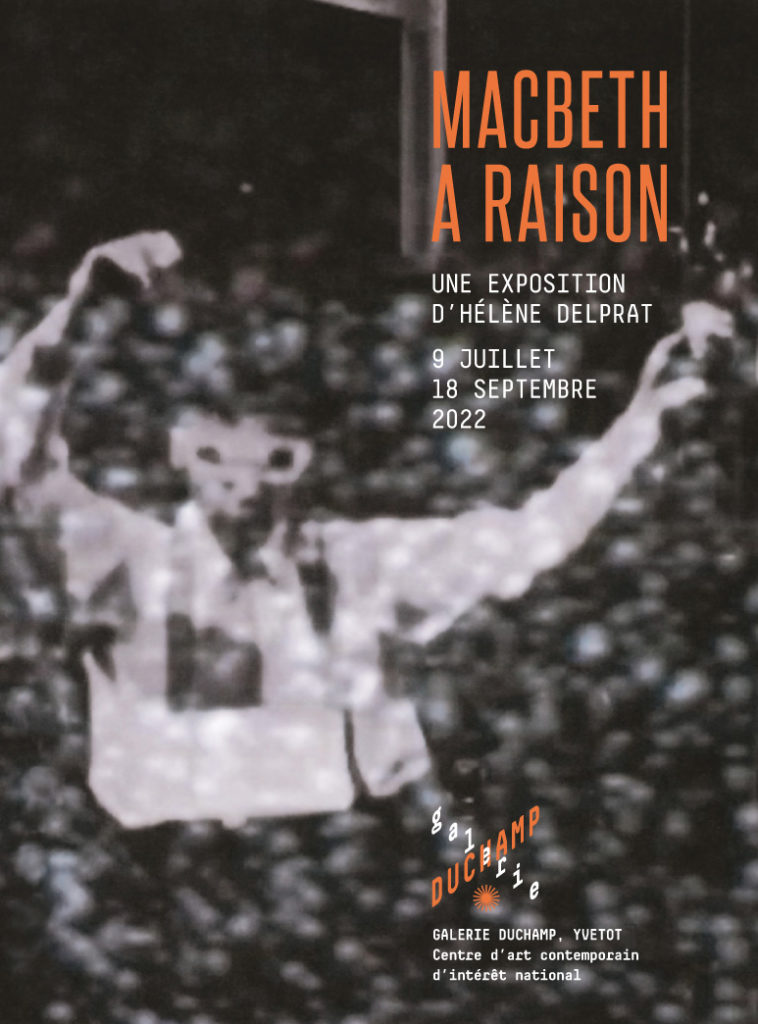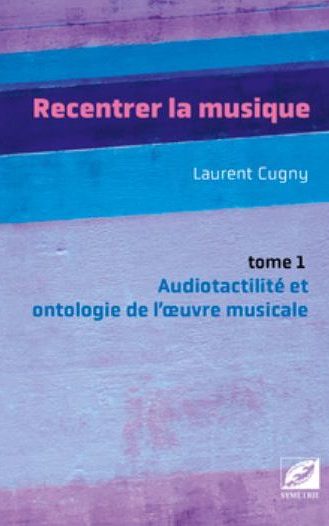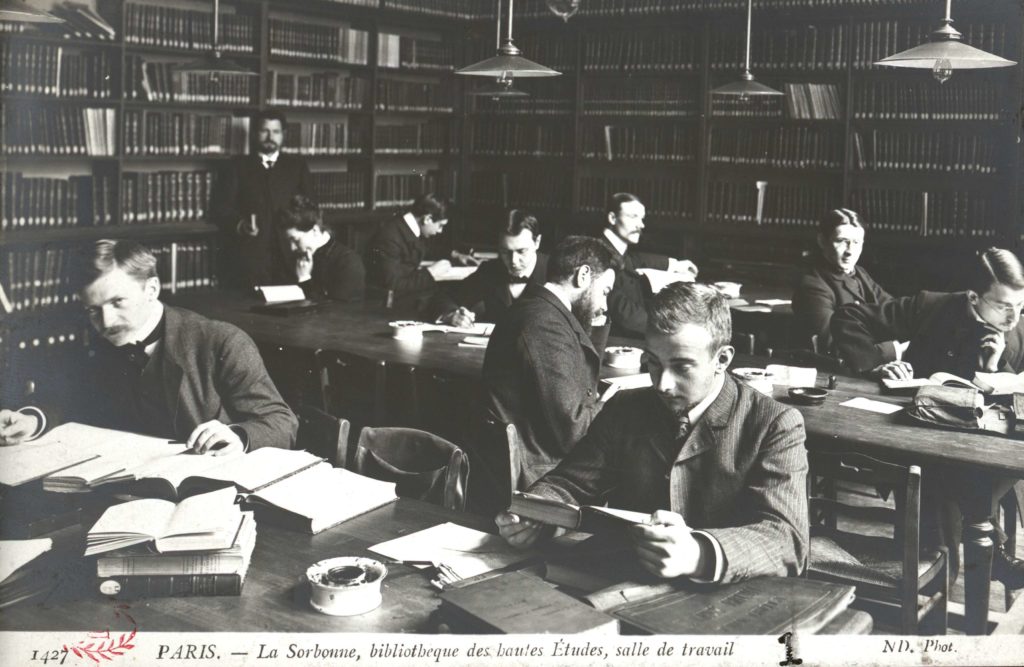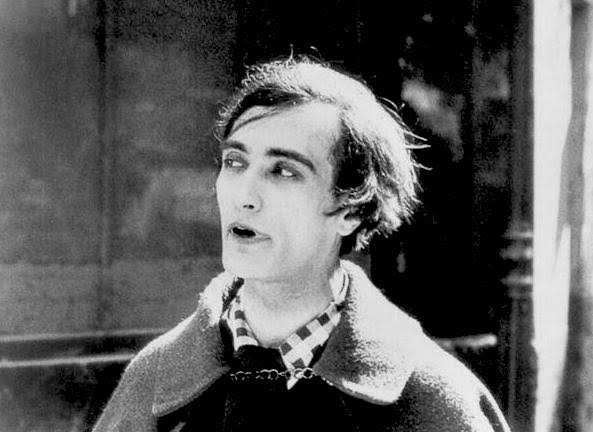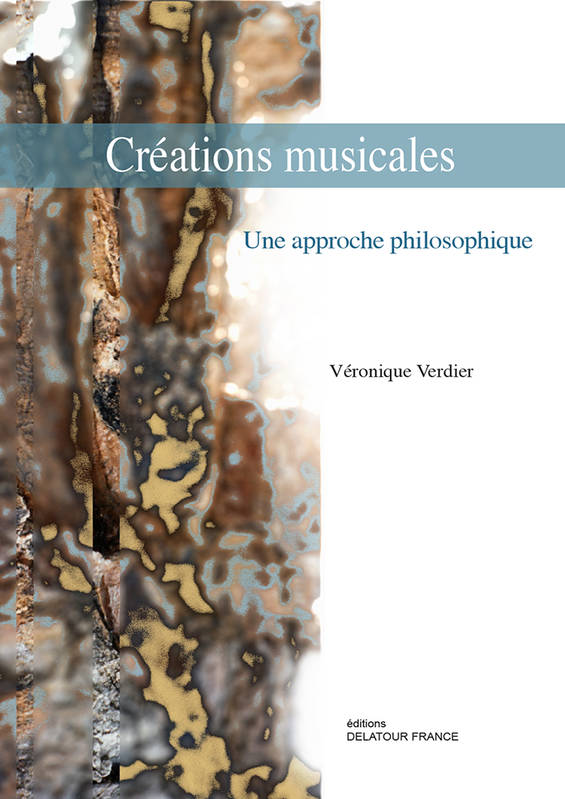Pour percer dans la musique, on peut se muscler de psychologie positive, chercher des recettes efficaces, tout faire pour marquer les consciences, utiliser des engrais qui permettent d’avoir des formes musicales assez standardisées pour, d’office, séduire le plus grand nombre qui, en général, est justement le nombre de ceux qui se laissent prendre aux formules mainstream. Ou alors, on peut choisir de manger bio, de se frotter à d’autres singularités, de composer avec ses zones de fragilité et d’affiner ses manières tout en élargissant son spectre d’attention.
Avec le soutien de la SACEM, Le Cerisier est un projet d’accompagnement artistique imaginé par le Projet Bloom, dans lequel quatre artistes du sonore sont suivis pendant une année. Au terme d’échanges suivis tout au long de la saison, les quatre artistes et toute l’équipe du Projet Bloom se retrouvent à La Tour de Guet, en Corrèze, l’association dirigée par Jean-Marc Chouvel (qui avait été l’invité du n° 2 – « Avancer » – de Metaclassique).
Pour la session de 2022, ce sont les artistes du sonore – dans l’ordre d’apparition à venir : Shao-Wei Chou, Hsinyun Tsaï, Aude Rabillon et Jean-Etienne Sotty qui ont été accompagnés, dans leur bourgeonnement, par – dans l’ordre de co-éclosion : Franck Mas, Frédéric Mathevet, Ivan Solano et Colin Roche. Le projet Bloom a invité Metaclassique à suivre l’intégralité de cette semaine de résidence à La Tour de Guet, dont voici une sorte d’album de famille.
Une émission produite et réalisée par David Christoffel.

Podcast: Play in new window | Download