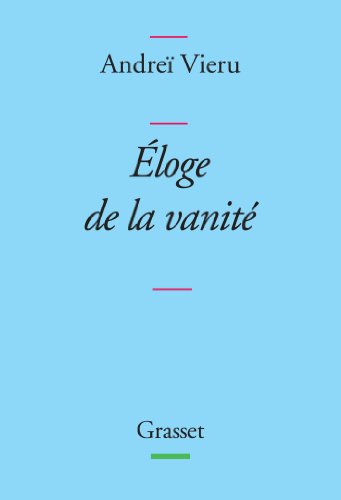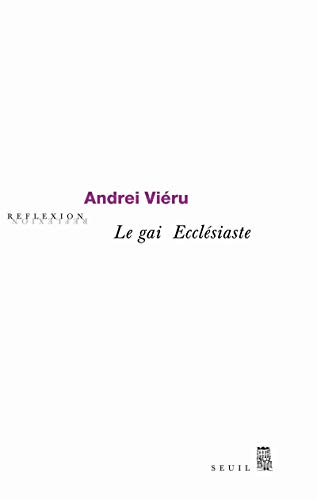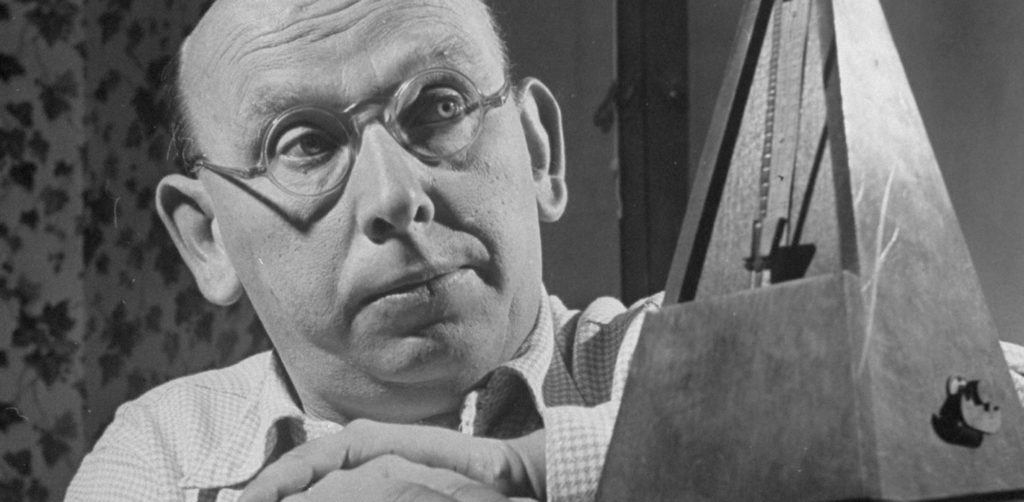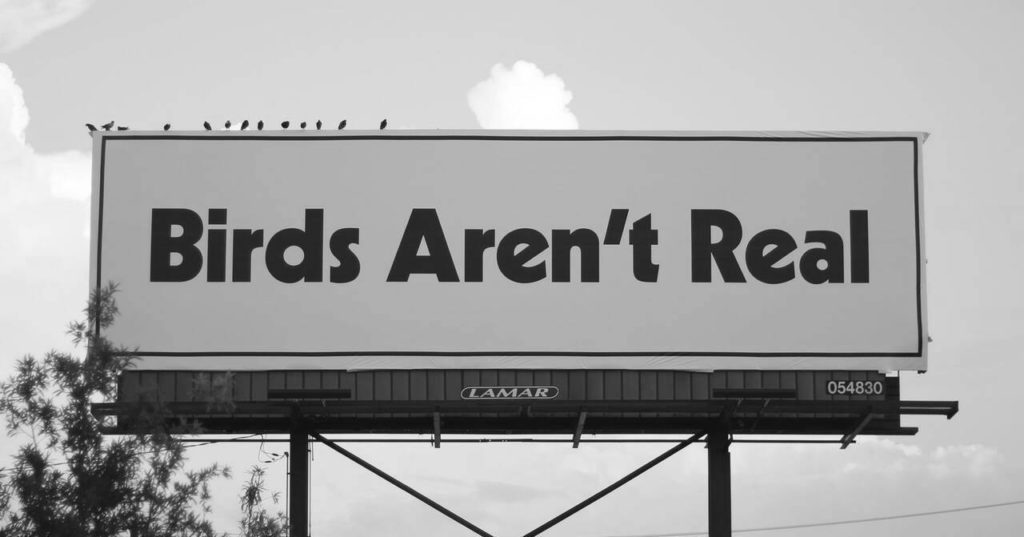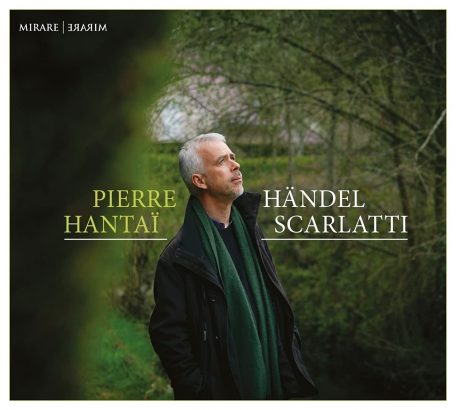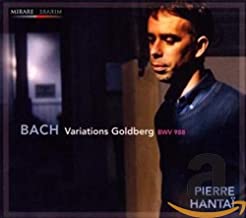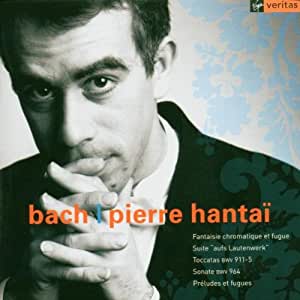Depuis les imitations de chants d’oiseaux par Vivaldi dans les Quatre saisons jusqu’aux polyrythmies du Festin pour 12 percussionnistes de Yan Maresz, le langage musical semble avoir évolué par éloignement de la préoccupation d’en référer à des contenus narratifs. Et si l’idée est admise que la musique est traversée par des figures rhétoriques, l’idée reste débattue de savoir si la musique peut réellement raconter une histoire par les seuls moyens de la musique. Le compositeur Gustav Mahler était lui-même affirmatif du pouvoir évocateur de ses symphonies tout en se donnant la liberté d’en déborder les figures, au point que la musicologue Anne-Claire Scebalt s’est lancée dans une thèse de musicologie en Sorbonne, sous la direction de Jean-Pierre Bartoli, pour fouiller les symphonies de Mahler avec les outils de la sémiotique. Une question apparaît aussitôt : est-ce que les associations de telle figure à tel signe musical ne sont pas arbitraires ? À quoi le linguiste et sémioticien Jean-Marie Klinkenberg prévient que « Tout signe motivé contient une part d’arbitraire, pour la raison qu’il est un signe[1] ». C’est d’ailleurs bien pour arbitrer ce que la sémiotique peut apporter à l’écoute des Symphonies de Mahler que nous avons réuni au Salon Mahler de la Bibliothèque La Grange Fleuret à Paris, la musicologue Anne-Claire Scebalt et le sémioticien Jean-Marie Klinkenberg.
Une émission produite et réalisée par David Christoffel.
[1] Précis de sémiotique générale, Paris, Editions du Seuil, 2000, p. 202.
Podcast: Play in new window | Download